ZYX: Macaire / Machin / Macron / Macronisme / Macronnade(s) / Macrorien / Marx / Mendiant / Merci / Mac Guffin
Publication consultée 1482 fois
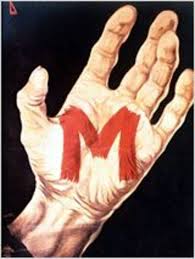
Macaire :
1/ Théâtre : brigand de mélodrame, bandit, filou adroit et cynique. "On tape le ministère; Chacun lui fait son paquet; Richelieu n'est qu'un macaire! Et Sully un paltoquet!" (Nadaud,Chansons,).
2/ Adjectif : Macairien, -ienne, qui est digne de Robert Macaire, propre à un homme de son espèce, exemple : « On y voit une troupe de malheureux couverts d'humides et boueux haillons, le chef orné de chapeaux macairiens » (Berlioz,Grotesques 1869).
3/ Substantif : Macairisme comportement cynique et malhonnête, digne de Robert Macaire, exemple : « Avec un magnifique macairisme, le digne frère d'Arsène s'était refusé avec fureur et indignation à rien commander avant le mois de janvier (ou juin ?)" (Goncourt,Journal,1857).
Machin :
1/ Substantif : pour désigner une chose, une institution dont on parle avec ironie (réelle ou feinte) « Que diable appelles-tu ton «machin sémantique», dont je ne sais rien, sinon qu'il «a paru»? Tâche alors qu'il paraisse jusqu'ici (Gide, Corresp.[avec Valéry], 1898).
2/ Politique : le général de Gaulle qualifia ainsi − le Machin − l'Assemblée générale des Nations Unies au moment où l'on discutait aux assises de cette organisation des mesures de répression prises par le gouvernement français contre les nationalistes algériens qui étaient alors qualifiés de rebelles.
3/ Profession : Ordre
Macron :
1/ Nom commun : diacritique de l'alphabet latin et grec qui prend la forme d'une barre horizontale (ˉ) que l'on place au-dessus d'une voyelle pour indiquer qu’elle est longue.
2/ Moderne : accent plat, le français n’utilise normalement pas de macron (sauf pour les transcriptions de termes étrangers, notamment arabes et japonais). Cependant les linguistes constatent que les élèves l’utilisent souvent dans leurs copies lorsqu’ils ont un doute quant au type d’accent à choisir, afin de ne pas à avoir à se prononcer, et ainsi éviter d’être pénalisés en cas d’erreur. Cette pratique est appelée « neutralisation de l’accent », et une étude montre que son usage est courant chez les adultes, s’est répandu dans les médias, est devenu un principe de gouvernement.
3/ Politique française : Ministre de l’accent plat.
4/ Substantif : Macronisme : comportement cynique et imbécile, digne de Macron, exemple, par captation (cf Macairisme) : « Avec un magnifique macronisme les dignes ordinaux s'étaient refusés avec fureur et indignation à s’associer au 85% de leurs confrères grévistes ».
5/ Nom : Macronnades : preuve de la délicatesse dont les avocats font preuve dans les débats publics. Constituée sur le mot Macron, une macronnade aurait dû être désignée comme une macronnerie. La constitution du corpus des macronnades est en cours et semble inépuisable, cela pose la question de leur catégorisation, faut-il distinguer celles seulement contraires aux avocats, celles concernant les professions du Droit dans leur ensemble, celles brimant l’expression démocratique, celles exclusivement dédiées aux transferts de richesses à destinations de quelques lobbys et oligopoles etc. ? La participation des lecteurs à ce corpus et à sa classification est la bienvenue.
6/ Adjectif : Macrorien : qui est digne de Macron, propre à des gens de son espèces, exemple par captation (cf Macairien) : « On y voit une troupe d’avocats macrorien préférant leur costumes et tailleurs à leurs robes » (voir les défroquées de Paris)
7/ Histoire : l’intelligence, la culture, le goût pour la littérature de Monsieur Macron lui ont fait espérer que le peuple de France discernerait la portée subversive de son personnage repris de toute pièce sur le modèle créé par Frédérik Lemaître, l’immense acteur du 19e, qui, pour éviter le naufrage du personnage théâtral sérieux et grandiloquent de Robert Macaire, en fit un rôle grotesque : captation[1] :
« Comment, sans faire rire, rendre ce personnage grossièrement cynique, ce détrousseur de grand chemin (…) poussant l’impudence jusqu’à se présenter comme Ministre, tout en préparant sa fortune comme on mange un morceau de fromage de gruyère !… Un soir, en tournant et retournant les pages de son projet de Loi Macron se mit à trouver excessivement bouffonnes toutes les situations et toutes les phrases des rôles du Premier Ministre et du Président, si elles étaient prises au comique. Il fit part au Ministre des Finances, garçon d’esprit, et qui comme lui se trouvait mal à son aise, de l’idée bizarre, folle, qui m’avait traversé l’imagination. Il la trouva sublime! ».
Macron espérait le même triomphe que Lemaître mais quand le public vit ce bandit venir se camper au perchoir de l’Assemblée dans cette position tant de fois reproduite, affublé de son costumes de TINA[2], pas un rire, des gens désespérément sérieux, nulle dérision.
Pourtant révolutionnaire et homme de gauche Monsieur Macron sait que Macaire annonce la révolution de 1848, alors il s’obstine en rajoute, surjoue, il veut croire qu’à force de pantalonnades la révolution, au moins une petite arrivera ; mais cela est en vain, la société du spectacle est passée par là.
Monsieur Macron aurait voulu être Lemaître, ou au moins le cent deuxième Macaire de Daumier, il dût se contenter d’être lui et d’avoir sa marionnette aux Guignols.
Marx (Karl) :
1/ Philosophie : auteur ésotérique d’un traité intitulé « Le Capital » dont la titre IV du chapitre premier est intitulé « Le caractère fétiche de la marchandise et son secret ».
2/ Poésie : poète méconnu, médiocre mais sincère, surtout dans ses poèmes d’amour.
3/ Contemporain : « Work in process ».
Mendiant :
1/Littérature : « Je demande l'aumône à la justice des hommes; je suis un mendiant affamé de justice, et mon honneur est en haillons" (Musset, Lorenzaccio, 1834)
3/ Religion : ordres religieux apparus au début du XIIIe., répondant à l'exigence de pauvreté volontaire, individuelle et collective, précurseurs des avocats.
3/ Profession : Aide juridictionnelle.
Merci :
Ce que l’auteur exprime à ses lecteurs, consœurs et confrères.
Mac guffin :
1/ Cinéma : Le MacGuffin est un prétexte au développement d'un scénario. Cela peut être un objet, un secret, mystérieux, sa description est vague et sans importance. Le Mac Guffin est ce qui motive les méchants et qui est de peu d'intérêt pour le spectateur. Car celui-ci ne doute pas que les méchants ont d'excellentes raisons de vouloir le Mac Gufffin[3].
2/ Hitchcock : « Deux voyageurs se trouvent dans un train allant de Londres à Édimbourg. L'un dit à l'autre : « Excusez-moi, monsieur, mais qu'est-ce que ce paquet à l'aspect bizarre que vous avez placé dans le filet au-dessus de votre tête ? — Ah ça, c'est un MacGuffin. — Qu'est-ce que c'est un MacGuffin ? — Eh bien c'est un appareil pour attraper les lions dans les montagnes d'Écosse — Mais il n'y a pas de lions dans les montagnes d'Écosse. — Dans ce cas, ce n'est pas un MacGuffin » ».
3/ Profession : Déontologie.
Pour les précédentes entrées alphabétiques cf. : le blog de l’auteur
[1] « Comment, sans faire rire, rendre ce personnage grossièrement cynique, cet assassin de grand chemin… poussant l’impudence jusqu’à se friser les favoris avec un poignard, tout en mangeant un morceau de fromage de gruyère !… Un soir, en tournant et retournant les pages de mon manuscrit, je me mis à trouver excessivement bouffonnes toutes les situations et toutes les phrases des rôles de Robert Macaire et de Bertrand, si elles étaient prises au comique. Je fis part à Firmin, garçon d’esprit, et qui comme moi se trouvait mal à son aise dans un Bertrand sérieux, de l’idée bizarre, folle, qui m’avait traversé l’imagination. Il la trouva sublime! » — Frédérick Lemaître, Souvenirs
[2] Extraits de la notice Wikipédia Robert Macaire : Quand le public vit ces deux bandits venir se camper sur l’avant-scène dans cette position tant de fois reproduite, affublés de leurs costumes devenus légendaires : Bertrand avec sa houppelande grise, aux poches démesurément longues, les deux mains croisées sur le manche de son parapluie, debout, immobile, en face de Macaire qui le toisait crânement, son chapeau sans fond sur le côté, son habit vert rejeté en arrière, son pantalon rouge tout rapiécé, son bandeau noir sur l’œil, son jabot de dentelle et ses souliers de bal, l’effet fut écrasant.
Rien n’échappa à la sagacité avide d’un public surexcité par ce spectacle nouveau et imprévu. Les coups de pied prodigués à Bertrand, la tabatière criarde de Robert Macaire, les allusions de toutes sortes furent saisies avec une hilarité d’autant plus grande que le reste de la pièce fut rendu par les autres artistes avec tout le sérieux et toute la gravité que comportaient leurs rôles.
Après 1830, avaient surgi un grand nombre de drames tout empreints des idées particulières d’ironie et de révolte contre toutes les autorités. Ce n’est pas l’un des signes les moins caractéristiques des années qui suivirent 1830 que la popularité du type de Robert Macaire, qui devint l’incarnation, à cette époque agitée, du crime facétieux, du vol spirituel et du meurtre jovial. (…)
Le public, qui semblait prendre un goût malsain à ce que Heinrich Heine appelait le « Robert macairianisme », à cette affectation de tout bafouer, de ne pas croire à la vertu, de rire du vice et de ne plus voir qu’une « blague » dans les sentiments honnêtes et généreux, acclama ce railleur impudent et vicieux. L’Auberge des Adrets devint une sorte de cadre élastique, de scénario complaisant où se renouvelaient chaque jour les improvisations les plus ébouriffantes.
La pièce jouée en 1832 était quelque peu différente du mélodrame primitif ; le troisième acte avait été supprimé et remplacé par une charge restée fameuse : les deux voleurs, poursuivis par les gendarmes, montaient dans une loge d’avant-scène et jetaient sur le plancher du théâtre les deux agents de la force publique assassinés, et figurés par des mannequins, puis aux applaudissements de la foule, ils concluaient par cette maxime : Tuer les mouchards et les gendarmes,Ça n’empêche pas les sentiments.
Au moment où Robert Macaire et Bertrand, entourés de gendarmes et de témoins, sentaient qu’ils allaient être découverts, ils se regardaient de travers : « Sortons, disait Macaire à Bertrand ; il s’agit de vider une affaire d’honneur. —Tenez, marquis, il vaut mieux que nous sortions ! » Au moment où l’on recherchait l’auteur du crime qu’ils venaient de commettre, Bertrand disait avec candeur au brigadier : « Tenez, Monsieur le gendarme, je propose une chose : c’est que tout le monde s’embrasse et que cela finisse ! »
Les lazzis des deux coquins obtenaient souvent des succès « d’actualités ». Lorsqu’on leur demandait leur profession, par exemple, leur choix dépendait alors de l’événement de la veille. Robert Macaire se faisait aéronaute et professeur dans l’art « d’enlever » des ballons ou encore, le lendemain d’un vol à la collection numismatique de la Bibliothèque royale : « conservateur des médailles ». Enfin Bertrand disait volontiers : « Ma femme prend des enfants en sevrage et je perfectionne leur éducation ».
La vogue de ce drame tragico-burlesque fut telle qu’elle inspira à Frédérick Lemaître l’idée de développer les deux types de bandits de Bertrand et de Robert Macaire, et de leur donner pour cadre une véritable comédie de mœurs. Il se mit à l’œuvre et écrivit avec Benjamin Antier et Saint-Amand, ses deux collaborateurs naturels, la pièce de Robert Macaire, pièce en quatre actes et six tableaux qui, après quelques péripéties, fut jouée aux Folies-Dramatiques le 14 juin 1834. Le succès fut colossal et fit la fortune du directeur Mourier. Le parterre fit aux deux coquins un accueil encore plus enthousiaste que précédemment, et, enhardis par leur popularité, les deux acteurs ajoutaient chaque soir quelque bouffonnerie plus cynique : « c’était leur fête de chaque jour, disait Jules Janin, de s’en aller tête baissée à travers les établissements de cette nation, de faucher à la façon de quelque Tarquin déguenillé, les hautes pensées, les fermes croyances, et de semer, chemin faisant, l’oubli du remords, le sans-gêne du crime, l’ironie du repentir. » Le public encourageait ces audaces en les applaudissant avec d’autant plus de frénésie qu’elles étaient plus irrespectueuses de toute autorité.
Chaque théâtre voulait avoir son Robert Macaire : l’un donna la Fille de Robert Macaire, l’autre le Fils de Robert Macaire, un troisième le Cousin de Robert Macaire. Aux Funambules on jouait Une émeute au Paradis, ou le Voyage de Robert Macaire. Après avoir grisé saint Pierre, le sinistre gredin lui volait les clefs du ciel, mettait le paradis en goguette et débauchait les saints et les anges ; le diable essayait, mais en vain, d’empoigner Robert Macaire qui restait le plus fort et le plus heureux dans l’autre monde comme sur la terre. Les plaisanteries sacrilèges étaient un des épices de cette pantalonnade blasphématrice où on pouvait entendre une oraison dominicale qui débutait par ces mots : « Notre père qui êtes dans la lune. »
Le gouvernement finit par interdire ces spectacles auxquels le public, surtout populaire, prenait un plaisir excessif qui l’inquiétait. Un soir que Frédérick Lemaître s’était « fait la tête » de Louis-Philippe pour jouer son rôle de Robert Macaire, la police intervint.
Le type ainsi lancé avait rapidement conquis une popularité qui ne devait plus s’éteindre. Il fut repris quelques années plus tard par Philipon, qui inspira au crayon de Daumier une série de lithographies représentant Robert Macaire dans toutes sortes de situations sociales pour devenir, selon le mot de James Rousseau dans sa Physiologie du Robert Macaire, « l’incarnation de notre époque positive, égoïste, avare, menteuse, vantarde… essentiellement blagueuse. » Ces dessins, qui parurent dans le Charivari, de 1836 à 1838, ont été réunis par l’éditeur Aubert dans un album intitulé les Robert Macaire.
[3] D’après la notice Wikipedia.
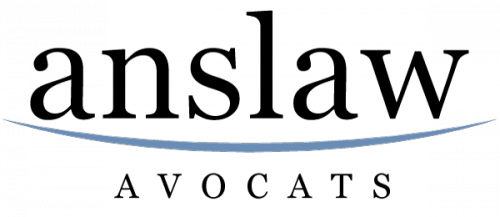
Commentaires
Soyez le premier à commenter cette publication